Les forces de droite, les précaires ministres Retailleau et Genevard en tête, ont entrepris de justifier avec d’insoutenables arguments le contenu de la loi Duplomb.
Nous relevons ici une série de contrevérités et leur apportons des réponses argumentées.
– « Il faut respecter la science », « il faut de la rationalité dans le débat »
Celles et ceux qui invoquent la science et la rationalité pour défendre la loi Duplomb n’écoutent précisément pas la science et les scientifiques. En effet, pas moins de 1300 chercheurs et soignants de l’INSERM, du CNRS ou d’INRAE se sont prononcés contre la loi Duplomb, mettant en avant son impact sanitaire et environnemental négatif.
La loi Duplomb a été votée contre l’avis de 22 sociétés savantes médicales ! Contre l’avis de La Ligue contre le cancer, contre l’avis des administrateurs de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, contre l’avis de la Fondation pour la recherche médicale, contre l’avis de 20 mutuelles et groupes mutualistes, contre l’avis du Conseil scientifiques du CNRS, contre l’avis de la fédération des régies d’eau potable.
Une étude scientifique suisse sur 14 enfants a montré que l’on retrouve chez 13 d’entre eux de l’acétamipride dans le liquide céphalorachidien (liquide ou baigne le cerveau et la moelle épinière). Une étude chinoise sur un échantillon de 300 personnes confirme les résultats de cette étude suisse.
– « L’alimentation française, en termes de qualité et de normes environnementales, est ce qu’il y a de mieux dans le monde »
Cet argument pétri d’un relativisme ne garantit pas la santé. Ainsi, s’il est vrai que la « grippe est moins pire que le covid », vous pouvez cependant mourir des deux. Il est démontré désormais que l’utilisation d’engrais phosphaté issus des importations marocaines chargé en cadmium prépare une crise sanitaire d’ampleur. On retrouve partout désormais des pollutions des eaux dites « potables ». En Bretagne, les nitrates provoquent la prolifération d’algues vertes toxiques. Les insecticides et pesticides multiplient les cancers, notamment dans les familles paysannes.
– Quand le président de la FNSEA dit à la télévision : « Ma fierté, c’est de produire une alimentation de qualité à destination de mes compatriotes », il se moque du monde.
Précisément, l’une des questions aujourd’hui posée est celle de la « souveraineté agricole et alimentaire » dans ce qui était un grand pays agricole. Or, aujourd’hui 43 % de la surface agricole utile de notre pays sert à produire pour l’exportation dans le cadre du « grand marché libre ». Et nous importons globalement 20 % de notre alimentation. Mais il existe désormais des secteurs comme les fruits et légumes où nous importons jusqu’à la moitié de notre consommation. La direction de la FNSEA berne les paysans, et ses adhérents, depuis les choix faits par Giscard d’Estaing, en valorisant le concept « d’agriculture, pétrole vert ».C’est à dire une agriculture pour l’exportation afin d’améliorer la balance commerciale de la France.
En réalité, c’est l’intégration de la production agricole dans la mondialisation capitaliste avec en amont, de grands secteurs industriels fournisseurs des moyens de production – engrais, machines, produits de traitements, etc – Et en aval les oligopoles de la transformation « agro-alimentaire » et les centrales de distribution.
Partant de là, la production agricole et alimentaire capitaliste considère l’alimentation telle une marchandise comme une autre avec des prix mondiaux déconnectés des coûts réels de production et la rémunération du travail paysan.
En effet, qu’y a-t-il de commun entre un agrarien brésilien qui exploite 3 000 voire 4 000 hectares et un paysan du Burkina Faso où même avec un paysan de la plaine de la Beauce ? Rien, bien sûr. Le prix mondial est donc une hérésie du capitalisme mondialisé. Dans cette compétition mondiale, les droites françaises – mais pas seulement malheureusement – ont voulu faire de l’agriculture non plus le cœur de l’alimentation, de la santé et du développement des territoires, mais une marchandise pour la balance commerciale. Pour cela, il a fallu en permanence compresser les prix à la production. Il y a une différence entre une orientation consistant à développer une agriculture vivrière et une agriculture d’exportation.
– « Les consommateurs sont-ils prêts à payer des produits de qualité ? »
Cette phrase, maintes fois répétée sur des plateaux TV, ainsi que les crachats de ministres à la tête creuse, vise d’un même mouvement à culpabiliser le paysan et le consommateur. Le paysan produirait trop cher et le consommateur voudrait des produits peu chers et de qualité. C’est typique de l’argumentaire de justification des aliénations. Si les mandataires du capitalisme s’acharnent à ne pas vouloir installer des prix « plancher » ou « de base » rémunérant le travail paysan, c’est précisément pour ne pas avoir à augmenter les salaires des salariés.
Le prix d’une alimentation tirée d’une production agricole de masse à prix bas – contre la rémunération du travail paysan – de plus en plus intégrée à la mondialisation capitaliste, réduit l’alimentation à une variable d’ajustement (relative) des budgets des ménages écrasés notamment par le prix du logement.
C’est la quadrature du cercle : les salariés ont besoin de manger pour renouveler leur force de travail. Le capitalisme ne veut pas (ou peu) augmenter les salaires et a donc besoin de mettre en circulation une alimentation dont le prix est contenu – même s’ils ont augmenté ces derniers temps en conséquence de l’organisation de la fluctuation des prix mondiaux à la production par les firmes transnationales. Ainsi, le prix du beurre flambe actuellement parce qu’on détruit à petit feu la production laitière. Le prix du café est également très élevé en lien avec les modifications climatiques et l’organisation du marché par les firmes capitalistes. Il conviendrait de développer cette analyse, mais, à grands traits, le capitalisme fait en permanence pression sur les prix agricoles pour ne pas à avoir à augmenter les salaires ouvriers.
– « Besoin d’eau pour continuer à faire de l’agriculture »
C’est vrai. Mais la construction des méga bassines répond à d’autres objectifs. Elle privatise l’eau pour une minorité de grandes exploitations au détriment des petites exploitations et de l’ensemble de la population. De plus, l’eau des méga bassines est obtenue par pompage des nappes phréatiques dont le niveau est en souffrance avec le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse. Une autre réponse existe depuis longtemps, celle des « lacs collinaires » qui mettent en réserve l’eau de pluie. Ajoutons qu’il faut se préparer à de nouvelles pratiques culturales tenant compte des modifications climatiques. Celles-ci s’opposent à l’industrialisation de l’agriculture et appellent le déploiement d’un processus vers l’agrobiologie. De nombreuses études et l’observation montrent que, à la différence des parlementaires au service de l’agrochimie et de l’agro-industrie, partout dans le pays, des paysans de tout horizon travaillent déjà avec de nouvelles pratiques, combinent l’amélioration de la vie des cheptels et des cultures (et y compris de leur santé) avec recherche de meilleurs revenus en diminuant les intrants – engrais, antibiotiques, produits chimiques.
– « L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est-elle d’accord avec l’utilisation de l’acétamipride ? »
Sur 290 substances chimiques actives utilisées en France, l’Union européenne s’apprête à en interdire la majorité d’ici l’année 2035, au point que le ministère de l’Agriculture préparait un programme de suppression de l’usage de 75 molécules chimiques.
Pour l’acétamipride, l’EFSA a conclu à la nécessité d’approfondir encore les travaux de recherche et a souligné des risques sérieux pour la santé humaine, celle des organismes aquatiques, des pollinisateurs (les abeilles notamment) et des oiseaux. Rappelons que les populations d’oiseaux se sont effondrées en Europe ces dernières années, en lien avec l’intensification agricole. Dans son dernier rapport publié en mai 2024 l’agence européenne confirme son évaluation en mettant en garde : « Des incertitudes majeures dans l’éventail des preuves de toxicité neurodéveloppementale (toxicité pour le cerveau) de l’acétamipride »
– « On est obligé d’utiliser les mêmes produits phytosanitaires que les autres pays européens pour rester compétitif »
On rejoint ici une conception de l’agriculture extractive de matières premières pour les marchés mondiaux.
Rien n’interdit à notre pays d’imposer ses propres règles plus strictes en matière de protection de la santé et de l’environnement. Elle le fait d’ailleurs dans certains cas. L’article 44 de la loi Égalim interdit la vente de produits agricoles et de denrées alimentaires qui ne sont pas autorisées à la production ou à la vente en France. Il suffit d’amender l’article 44 de cette loi pour interdire aussi les produits d’importation – qui ne respectent pas nos règles sanitaires et environnementales – destinés à la vente.
Ce n’est, en effet, pas un hasard si la loi n’a pas prévu d’exclure les produits importés. La FNSEA, et les droites n’en disent mot très bizarrement !
Pourtant, un rapport du Sénat avait calculé une fourchette entre 10 % et 25% de produits importés en France qui ne respectent pas les règles minimales imposées aux producteurs Français.
En cas de menace grave pour la santé et l’environnement, il est possible de faire déclencher « la clause de sauvegarde européenne » pour protéger nos producteurs, la santé et l’environnement.
Il se dit aussi que les produits néonicotinoïdes enrobés ne seraient pas dangereux pour les abeilles. Certains ajoutent que du fait du non-fleurissement de la betterave à sucre, il n’y a aucun risque puisque les abeilles n’y vont donc pas butiner. Or, les pollinisateurs vont butiner les repousses de racines brisées qui elles fleurissent et les mauvaises herbes qui sont forcément contaminées par les molécules présentes dans les sols. Elles aussi fleurissent et attirent des abeilles. Ajoutons que les molécules chimiques restent longtemps dans les sols et restent toxiques pour tous les insectes et peuvent être absorbées par la culture suivante, possiblement attirante des pollinisateurs. L’enrobage est aussi nocif que les pulvérisations.
– « Les normes environnementales tuent l’agriculture »
Ce qui tue l’agriculture, c’est la concentration agraire, c’est l’endettement et le surendettement des paysans, ce sont les prix insuffisants et le marché mondial.
Ce qui tue l’agriculture, c’est le réchauffement climatique comme l’a montré le Haut Conseil pour le Climat en 2024 qui montre que la production agricole est menacée dès l’année 2035. (Cliquez ici pour accéder au site du Haut Conseil pour le Climat). Dans le cas de la betterave à sucre, la prolifération de pucerons est liée aux modifications climatiques avec des températures hivernales moyennes qui augmentent.
– « Il n’y aurait pas d’alternative »
Au nom de ce mensonge il faudrait accepter le développement des cancers et d’autres maladies ?
Alternative technique ? La réintroduction de l’acétamipride concerne environ 400 000 hectares pour la culture de betterave sucrière et des noisettes. En passant, il s’agit pour la betterave d’alimenter des méthaniseurs pour du biocarburant. Et la noisette est la plupart du temps utilisée pour fabriquer le Nutella.
Ce pesticide est destiné à combattre le puceron vert, qui transmet le virus de la jaunisse aux betteraves et décime les cultures.
En 2018, une expertise collective d’Inrae et de l’Anses avait listé et analysé l’ensemble des alternatives disponibles, leur efficacité, leur possible utilisation et leur durabilité.
Après deux ans d’études il a été conclue que: 96 % des utilisations de néonicotinoïdes disposent d’alternatives efficaces. Dans 8 cas sur 10, ces alternatives ne sont pas chimiques : il peut s’agir d’application d’une couche d’argile protectrice, de lutte via des micro-organismes, de perturbation de l’accouplement, etc.
Il a été proposé aux betteraviers qu’une seule alternative chimique pour lutter contre le puceron vert : l’association de deux pesticides, le lambda-cyhalothrine et le pyrimicarbe. Puis en 2021, une mise à jour de l’avis, des deux agences sur la lutte contre la jaunisse de la betterave, ont ouvert la voie à plusieurs solutions.
Quatre d’entre elles sont immédiatement disponibles : deux insecticides (flonicamide et spirotétramate) et des techniques à appliquer sur les parcelles (paillage et fertilisation organique) doivent permettre de réduire les pucerons. À noter que les deux insecticides proposés ont des effets moindres sur l’environnement et seraient bien plus efficaces que l’acétamipride.
Et, l’Anses a établi que dix-huit autres solutions pourraient être disponibles dans les 2 à 3 ans ; Il s’agit des stimulateurs de la défense des plantes et l’utilisation de cultures compagnes permettant de réguler les populations de ravageurs. Ces méthodes ne sont pas suffisantes à elles seules. L’agence recommande donc de poursuivre les études pour identifier les combinaisons les plus prometteuses.
L’alternative fondamentale ? Repenser nos méthodes et revenir à l’agronomie contre le diktat des firmes chimiques. Du reste, dans un rapport publié en 2023 de l’inspection générale de l’agriculture insistait sur la nécessité de rechercher des alternatives en matière de protection des cultures. « La reconception des systèmes de production s’impose : la protection des cultures, en transition agroécologique, passe par un profond changement des itinéraires techniques et des modes de production » y est-il écrit. (Cliquez ici pour lire : Produire de l’alternative en protection des cultures – Retour d’expérience)
Mais ceci s’oppose à la mainmise des secteurs d’amont – firmes des semences, de l’engrais des machines, des banques – et des secteurs d’aval, celui qui achète les aliments – industries de collecte, de transformation, de distribution. Bref, cela s’oppose aux mécanismes capitalistes qui broient les petits et moyens paysans et s’enrichissent sur le consommateur.
Travaillons à l’unité des tous les travailleurs.
– Attention, comme Trump, le gouvernement veut contrôler ou détruire les agences de sécurité sanitaires et alimentaires
Alors que la loi ne traite pas avec précision des missions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), un décret publié en catimini le 8 juillet prévoit deux dispositions particulièrement préoccupantes. L’une permet au ministre de l’Agriculture de décider, par arrêté, d’une liste de pesticides qu’il souhaite voir examiner de manière prioritaire et contraint l’Anses à prendre en considération cette liste dans la définition de son calendrier d’autorisation de mise sur le marché.
Il s’agit d’une pression directe sur l’agence veillant à la qualité alimentaire et à l’environnement, – l’Anses -, qui devra désormais d’abord examiner les demandes de pesticides choisis autoritairement par le ministre.
La seconde disposition, complémentaire de celle-ci, introduit dans les critères de mise sur le marché, celui dit « de condition agronomique ». Ceci cache en fait la volonté de permettre l’utilisation de produits dont la nocivité est avérée, mais jugée par certains indispensables à la production.
L’affaire est grave. Laisser seul le ministère de l’Agriculture prendre de telles décisions est contraire à notre droit puisque l’Anses est sous la triple tutelle des trois ministères.
Les principes de précaution et de prévention, qui, tous deux, figurent dans la Constitution, sont allègrement violés, tout comme le principe de non-régression. L’indépendance de l’Anses est mise en cause, ainsi que la possibilité de faire prévaloir les critères de santé et environnementaux sur les enjeux d’augmentation de la productivité – afin de ne pas traiter ceux de la rémunération du travail paysan.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État devraient être saisis immédiatement.
Amplifions le grand mouvement citoyen en cours.
Plus de deux millions de signatures de la pétition Non à la Loi Duplomb — Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective. SIGNER
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay
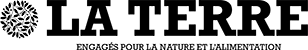
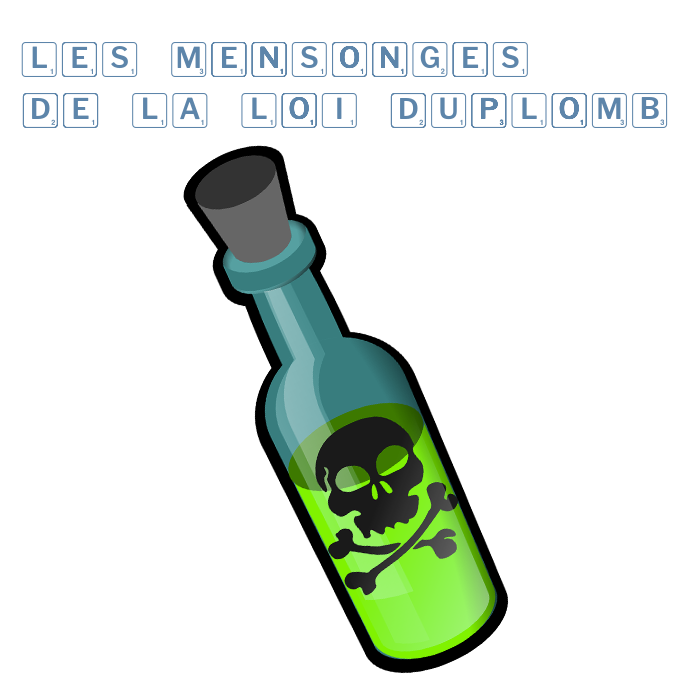




Vous devez être connecté pour publier un commentaire. Login