Par Nicolas Pauthe, Maître de conférences en droit public, Le Mans Université
C’est une décision qui a fait grand bruit au cœur de l’été. Celle du Conseil constitutionnel de censurer l’article de la loi Duplomb qui prévoyait des dérogations à l’interdiction de certains pesticides comme l’acétamipride. La controverse qu’une telle loi a suscitée montre qu’un débat sur l’inscription du droit à l’alimentation dans la Constitution est nécessaire.
La décision du Conseil constitutionnel rendue le 7 août 2025 sur la loi Duplomb renforce la nécessité d’un débat à avoir sur l’alimentation. C’est un des besoins les plus fondamentaux des êtres humains, pourtant elle ne trouve pas de traduction juridique directe dans la constitution française. Sans droit constitutionnel à l’alimentation, les interventions du Conseil restent en effet limitées pour faire face aux difficultés que rencontre le système de production alimentaire en place.
Dans sa décision d’août dernier, le juge constitutionnel a censuré l’article 2 de la loi. Ce dernier prévoyait des cas de dérogation possible à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Étaient concernés par cette dérogation certains pesticides comme l’acétamipride, dont les effets néfastes pour la santé humaine et les écosystèmes ont pourtant été démontrés.
Le Conseil a motivé la censure de l’article 2 en expliquant que celui-ci n’encadrait pas assez les dérogations possibles pouvant permettre d’utiliser les pesticides en question. Le juge constitutionnel a donc empêché ces dispositions d’entrer en vigueur. À charge pour le législateur de proposer une nouvelle loi. Il pourrait ainsi réintroduire cette possibilité de dérogation en étant plus précis, en limitant notamment l’étendue des filières agricoles concernées. Il lui faudrait par exemple détailler celles pour lesquelles cette exception serait justifiée par la menace d’une particulière gravité compromettant leur production. Le sénateur Duplomb a d’ailleurs annoncé réfléchir à la rédaction d’un nouveau texte en ce sens. Dès lors, si victoire des opposants à la loi Duplomb il y a, sur ce point, celle-ci reste limitée.
Un rendez-vous démocratique pour repenser la production de notre alimentation
Si le débat de fond reste en effet loin d’être tranché, ce n’était pas au Conseil de le faire. Cette tâche incombe au pouvoir constituant. En agissant ainsi, le pouvoir constituant permettrait d’initier une réflexion plus large sur la manière de produire notre alimentation.
L’enjeu serait aussi de faire dialoguer deux camps en apparence irréconciliables au sein de la société. La démarche devrait donc rassembler le plus largement possible. Faire progresser le processus constitutionnel jusqu’au référendum permettrait à chacune et à chacun de contribuer à repenser notre destin alimentaire commun, puisque aucune disposition constitutionnelle n’aborde la question alimentaire, contrairement à de nombreuses constitutions dans le monde.
L’organisation d’un tel débat paraît respectueuse des deux camps opposés au sujet de la Loi Duplomb. Elle l’est, d’abord, à l’égard des partisans de cette loi. Ceux-ci mettent l’accent sur le fait que l’interdiction française de certains pesticides aurait pour conséquence l’importation de produits agricoles venant de pays où ces pesticides continuent à être autorisés. Dès lors, quelles solutions proposer tout en préservant l’économie et la santé des agriculteurs comme des mangeurs ?
Mais le débat irait également dans le sens des détracteurs du texte. Ils revendiquent quant à eux le développement d’une agriculture sans pesticides en utilisant, ou en recherchant des solutions alternatives. Le cœur du problème se situe de fait autour de notre production alimentaire. Aucun agriculteur n’a raisonnablement l’intention d’empoisonner les consommateurs avec le fruit de son travail. De même, aucun mangeur ne souhaite rationnellement la faillite des agriculteurs. En proie aux désaccords sur la loi Duplomb, la société doit se réunir lors d’un rendez-vous démocratique pour fixer un cadre renouvelé aux enjeux alimentaires. Celui-ci pourrait avoir lieu dans un avenir proche.
L’opportunité du droit constitutionnel à l’alimentation
Lors de la prochaine session parlementaire, le Sénat pourrait ainsi avoir à débattre d’une proposition de loi constitutionnelle à l’initiative des écologistes. Celle-ci vise à consacrer le droit à l’alimentation au sommet de la hiérarchie des normes. Le texte reprend l’article 38A de la constitution du canton de Genève en Suisse, adopté en 2023 par votation populaire, grâce au suffrage favorable de 67 % des votants :
« Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim. »
L’adéquation est ici celle des aliments avec les choix des mangeurs. Cela inclut celui de ne pas consommer d’aliments cultivés avec des pesticides. Le droit à l’alimentation implique ainsi de mettre en place une alternative effective dans le choix des denrées alimentaires à disposition du mangeur. Dans le canton de Genève, le débat porte désormais sur la concrétisation de ce nouveau droit dans le cadre d’une loi qui pourrait être soumise à la discussion du Parlement en 2026.
En France, les sénateurs pourraient saisir l’occasion qui leur est donnée d’investir un débat de fond tout juste effleuré avec la loi Duplomb. La modification constitutionnelle qui pourrait en résulter aurait pour incidence de guider l’action future du Conseil constitutionnel. La jurisprudence environnementale du Conseil a une nouvelle fois progressé avec la décision du 7 août 2025. Certaines dispositions de la Charte de l’environnement, qui ont valeur constitutionnelle, étaient difficilement utiles ici pour contester l’autorisation de dérogation à l’interdiction des néoniotinoïdes. Par exemple, le principe de précaution de l’article 5 ne s’applique pas lorsque les risques sont avérés. Or ceux liés à l’utilisation de ces néonicotinoïdes sont bel et bien prouvés. Le Conseil a donc été plus ambitieux, en plaçant le droit à l’environnement sain et équilibré de l’article 1er au niveau des autres droits et libertés fondamentaux. Cette décision inédite laisse notamment entrevoir un développement possible de l’idée de non-régression du droit de l’environnement.
Mais l’évolution dans le cadre de laquelle s’inscrit la décision du 7 août dernier reste toujours lente et incertaine. Surtout, la dimension environnementale n’est que l’un des aspects du droit à l’alimentation. Quid du bien-être animal, de l’encouragement des circuits courts, ou de la rémunération des producteurs ? La réflexion sur l’alimentation doit en effet inclure le point de vue environnemental, mais elle doit aussi pouvoir être traitée de manière plus globale.
Des choix essentiels à faire
Plusieurs discussions pourraient alors être ouvertes par le débat sur la constitutionnalisation du droit à l’alimentation, prolongeant la controverse suscitée par le feuilleton estival autour de la loi Duplomb.
Tout d’abord, quelle forme de souveraineté alimentaire développer ? La Déclaration sur les droits des paysans adoptée en 2018 par l’Assemblée générale des Nations unies, mais non contraignante pour la France, reconnaît par exemple
« le droit des peuples de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et durables respectueuses des droits de l’homme ».
Le gouvernement semble, lui, opter pour l’exportation des produits agricoles en vue d’accentuer la compétitivité des acteurs économiques, au prix de régressions environnementales assumées. Ce choix a également pour incidence de faire dépendre notre modèle agricole de l’importation importante de pesticides et engrais chimiques, ce qui semble contradictoire avec l’idée de souveraineté.
Ensuite, comment rendre cohérent le droit français avec les engagements extérieurs ? Le droit constitutionnel à l’alimentation inciterait la France à appliquer ses engagements internationaux. Certains textes consacrent le droit à l’alimentation, comme l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, selon lequel :
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation […]. »
Mais l’efficacité du droit international en la matière reste faible, car ces textes n’ont pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne et les autorités françaises n’ont pas pris de mesures suffisantes pour les rendre effectifs. De même, la controverse sur la production de l’alimentation ne saurait être levée sans une réflexion au niveau européen. À cet égard, l’alimentation doit-elle encore être traitée comme une marchandise ordinaire ?
Enfin, comment concrétiser le droit à l’alimentation ? La réflexion devra se prolonger sur les contours et le contenu d’une loi-cadre. Celle-ci pourrait notamment définir les compétences d’intervention de chaque niveau décisionnel au service d’une telle concrétisation. Comment par exemple encourager et renforcer les pratiques de « démocratie alimentaire » qui pullulent déjà à l’échelon local ?
Dans l’attente d’un débat national sur ces questions, les signataires de la pétition contre la loi Duplomb auront bientôt l’occasion de faire entendre à nouveau leur voix, sur la scène continentale cette fois. Le 8 juillet, la Commission européenne a enregistré une initiative citoyenne visant à faire reconnaître le droit à l’alimentation au sein de l’Union, et à promouvoir « des systèmes alimentaires sains, justes, humains et durables pour les générations actuelles et futures ». Les citoyens pourront prochainement y joindre leur signature. La Commission aura alors la possibilité de décider d’agir dans le sens escompté si le million de signatures est atteint, réparties entre au moins sept États membres.
Débattre d’une constitutionnalisation du droit à l’alimentation placerait ainsi la France au cœur des enjeux européens. Cela lui permettrait de mieux faire entendre sa voix le moment venu en montrant l’exemple à ses partenaires.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay.
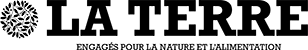





Vous devez être connecté pour publier un commentaire. Login